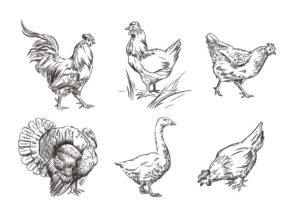Deux fois par jour, en nous mettant à table, nous trouvons devant nous l’assiette de porcelaine blanche, le linge fin recélant un petit pain doré, le couvert d’argent disposé à portée de la main, le verre de cristal, le sel blanc, le poivre… — je ne poursuis pas l’énumération, — et jamais, jamais, il ne nous vient à ce moment une pensée reconnaissante pour l’innombrable lignée d’ancêtres de goût ou de génie dont le labeur, le talent, les souffrances et le merveilleux effort vers le mieux nous valent ces commodités et ce bien-être, si coutumiers que nous n’y prêtons pas attention.
Pour qu’un employé, qui met dix francs à son déjeuner, puisse s’asseoir dans le plus banal des Bouillons et faire son choix sur une carte de vingt mets différents, vin, bière ou lait à volonté, avec couteau, cuiller, fourchette et une nouvelle assiette à chaque plat, il a fallu que, depuis deux ou trois siècles, les plus grands seigneurs et les plus opulents financiers aient imaginé l’un après l’autre tous ces raffinements de service, toutes ces sauces, tous ces entremets, dans le but de surprendre et d’émerveiller quelque amie dont ils recherchaient les bonnes grâces ou quelque puissant ministre dont ils sollicitaient la faveur. Détaillons un peu.
Le pain ?
C’est une très récente conquête de l’industrie. Celui que mangeaient nos pères était roux, sec, plein d’avoine et d’orge ; le fameux pain de Gonesse, si vanté au XVIIIe siècle, n’arrivait à Paris que deux fois par semaine, et les gourmets s’en délectaient, tout en s’y cassant les dents. Le croissant, l’admirable croissant d’un sou de la midinette, feuilleté, croustillant et tendre à la fois, aurait été pour Louis XIV une révélation de délices inconnues.
Le beurre ?
Des régions entières n’en goûtaient jamais : le Midi, par exemple, où s’est perpétuée, et pour cause, la cuisine à l’huile. Les favorisés ne connaissaient que le beurre rance ou salé. Ce sont les Danois qui ont enseigné à nos fabricants bretons et normands l’art de confectionner cette base de toute cuisine qui se respecte. — La viande ? Que pouvaient être ces bêtes pâturant au hasard, dans les jachères, dans les forêts ; ces bœufs e ces vaches nourris de feuilles d’arbres ? Le troupeau moderne est l’œuvre d’agriculteurs anglais et hollandais qui, à la fin du XVIIIe siècle, commencèrent à sélectionner habilement les animaux de boucherie et à obtenir des sujets donnant le maximum de viande et le minimum d’os. Un bœuf gras, jadis, était une si rare merveille que lorsqu’on en tenait un, on le promenait en triomphe dans Paris ; de nos jours, il en arrive quotidiennement, aux abattoirs, huit cents, qui tous auraient, il y a cent ans, mérité ce suprême honneur. —
Le poisson ?
Celui de mer était si rare, au XVIIe siècle, qu’à l’époque du carême, le grand Condé tirait un revenu de plus de cent mille livres du poisson pêché dans son lac d’Enghien ; imaginez-vous le fumet de ces carpes et de ces anguilles sorties de la boue sulfureuse ? A part cela, rien que du maquereau et du hareng dans la saumure. A présent, les domestiques de bonne maison, en Angleterre, stipulent qu’on ne leur fera pas manger du saumon plus de trois fois par semaine, et chez nous, la carte du plus modeste restaurant présente de la sole, de la raie, de la langouste, du merlan, des moules dans la saison, du rouget, du turbot… toutes choses qui, avant les transports rapides, étaient réservées, comme curiosités, aux tables royales.
Les légumes ? On n’avait, comme farineux, que le pois chiche et la fève, trop délaissée ; le haricot, l’asperge et le melon comptent à peine quatre siècles d’acclimatation ; l’aubergine, le salsifis et le chou- fleur ont cent ans de moins; le petit pois date de Louis XIV et le XVIIIe siècle a conquis la betterave, la tomate et la pomme de terre. — Le sel coûtait trois francs les deux livres; le sucre, dix francs; on l’achetait, comme denrée précieuse, chez les apothicaires; la livre de safran se payait cent francs et, si l’on mangeait une salade, on n’y pouvait mettre de l’huile, car, avant sa culture régulière, son raffinage savant et sa conservation soigneuse, l’huile d’olive était immangeable : elle servait à garnir les lampes.
Le vin ?
On ne le mettait pas en bouteille, pour la bonne raison que la bouteille n’était pas inventée : on le tirait au tonneau; il s’aigrissait, s’éventait, et la coutume était d’abandonner à la domesticité la barrique aux trois quarts vide. D’ailleurs le vin ne voyageait guère, ou s’il voyageait, c’était dans des outres en peau de bouc. Nos aïeux buvaient, sans broncher, du Suresnes et de l’Argenteuil. François Ier a bu du vin de Normandie et Philippe-Auguste du vin picard.